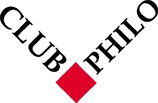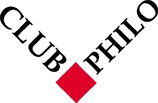|

Galerie de portraits
ll Dictionnaire du Club
| Luc
Ferry, Une
sagesse de l'amour,
Entretien réalisé par Jacqueline Rémy
|
 |
Le Club de Philosophie
remercie vivement le magazine L'Express d'avoir
bien voulu lui accorder le droit de reproduire, à
titre gracieux, l'intégralité de l'entretien
de Jacqueline Rémy avec Luc Ferry, publié
dans l'Express du 12 octobre 2006.
Droits réservés
Bien plus qu'un exercice de réflexion, la philosophie
est, pour l'auteur de Vaincre les peurs (Odile
Jacob), une doctrine de «salut sans dieu».
A la fois tentative de réponse par la raison
- et non par la foi - à la question de la mort
et quête d'un nouvel humanisme. Entretien.
Photo : L'Express, 12
octobre 2006
Format
PDF (107 Ko)
|
|
|
|
Vous
annoncez que la philosophie permet de vaincre les peurs. Est-ce
pour cette raison que la philosophie connaît aujourd'hui
tant de succès?
- Ce n'est pas nouveau, c'est un retour à la normale.
A toutes les époques de son histoire, la philosophie
a rencontré un public très important, même
à un haut niveau. Précisément parce qu'elle
était présentée comme ce qu'elle est
en réalité: non pas simplement un exercice de
réflexion critique, mais une tentative d'aider les
êtres humains à vivre mieux, et donc un amour
de la sagesse.
Au fond, ce n'est pas le succès de la philosophie
qui vous étonne, mais plutôt son relatif insuccès
pendant quelques décennies, en gros, des années
1960 aux années 1990, c'est cela?
- C'est bien l'idée que j'ai. Le charme de la déconstruction
ou du poststructuralisme, qui ont dominé les années
1960 et 1970 - ce que j'ai appelé la «pensée
68» - c'est qu'il s'agit de philosophies avant-gardistes,
réservées à une élite, autour
de Deleuze, Derrida, Foucault. Ultracritique, la pensée
68 a voulu déconstruire une tradition triomphante qui
est celle de l'Occident, du rationalisme classique. Elle est
donc à la fois assez ésotérique, volontiers
obscure et de toute façon marginale par goût,
d'où sa séduction. Mais c'est plutôt ce
moment-là qui fut une exception dans l'histoire de
la philosophie. Car il y a toujours eu des best-sellers de
la pensée, d'Epictète à Sartre, en passant
par Rousseau et Kant. Entre les deux éditions de la
Critique de la raison pure (1781 et 1787), un ouvrage
pourtant incroyablement difficile à lire, 3 000 publications
lui ont été consacrées. Même aux
Etats-Unis, sur John Rawls, probablement l'auteur sur lequel
on a le plus écrit, il y eut des dizaines et des dizaines
de milliers de publications en quelques années, juste
après la sortie, en 1971, de sa Théorie
de la justice. L'existentialisme a fait l'objet d'une
mode, et Sartre a été un personnage sacralisé. |
Luc Ferry,
‘‘Une
sagesse de l'amour'', (PDF, 107 Ko)
par Jacqueline Remy
Entretien publié dans L'Express
du 12/10/06 |
 |
N'avez-vous pas le sentiment que vous,
les «nouveaux» nouveaux philosophes à la
mode, prenez un peu le relais des psys? N'êtes-vous pas
des «marchands de bonheur», pour reprendre une expression
que vous dénoncez?
- Relisez Epictète ou Epicure. Les grands philosophes
parlent de la peur de la mort, c'est l'un de leurs thèmes
principaux. La philosophie est même présentée
à l'époque comme une thérapie, et cela
restera une constante. Pour autant, je ne crois pas que la philosophie
permette d'extirper les peurs.
Alors, pourquoi titrez-vous votre livre Vaincre
les peurs? Il est vrai que vous en rabattez, finalement,
puisque, au dernier chapitre, vous promettez seulement de les
«apprivoiser»: vous n'y croyez pas vous-même!
Est-ce que la religion n'est pas plus efficace pour vaincre
les peurs?
- Si, elle est mille fois plus efficace quand on y croit. Trois
discours nous promettent de faire quelque chose des peurs: le
discours religieux, le discours psy et le discours philosophique.
La particularité du discours philosophique, c'est, comme
le dit très bien Epictète, non pas de prétendre
nous débarrasser des peurs, mais de nous apprendre à
en faire quelque chose, de les vaincre, au sens où le
judoka fait quelque chose de la force de son adversaire: il
s'en sert comme d'un levier. Cela dit, je n'ai jamais rencontré
de croyant véritablement débarrassé des
peurs. Quant à mes amis en analyse, je les vois généralement
en proie aux mêmes phobies après dix ou vingt ans
de divan.
La philosophie, tout de même, n'a pas les
moyens de nous promettre la lune, contrairement à la
religion, qui, elle, propose une alternative à la mort.
- Le Christ, en particulier, nous propose la plus belle alternative
qui soit, en nous promettant de retrouver les gens qu'on aime
après la mort. Très bien. Mais il faut y croire.
Et encore… Je ne pense pas qu'on se débarrasse
des peurs au sens où on les exterminerait. C'est une
illusion. On apprend à vivre avec elles ou à les
apprivoiser, comme le Petit Prince avec son renard. Se sauver
de la peur, c'est la transformer en quelque chose d'utile, de
positif. Est-ce qu'on agirait si on n'avait pas peur? D'ailleurs,
je ne crois pas au bonheur.
Vous ne croyez pas au bonheur, ou est-ce un concept
sans intérêt?
- Je n'y crois pas, parce que la chose est indéfinissable.
Kant disait que c'est une idée de l'imagination, sans
contenu. Le bonheur n'est pas un état stable auquel on
pourrait parvenir comme au bout d'un jeu de l'oie. |
La
philosophie ne peut-elle pas nous aider à être
heureux?
- Pas exactement. L'état auquel la sagesse pourrait
éventuellement nous permettre d'accéder, c'est
la sérénité, ce qui n'est pas la même
chose. On peut mettre les peurs à distance, c'est l'un
des messages du stoïcisme ou du bouddhisme. Apprendre
à vivre, en particulier, avec la mort de l'autre. Ce
qui nous impose un certain nombre d'impératifs qui
ne sont pas moraux mais relèvent de la sagesse. Comment
vivre avec les gens qu'on aime en ayant la pleine conscience
qu'ils sont mortels? Questions que la religion et la psychanalyse
ont tendance à évacuer, la première en
nous disant que nous sommes immortels et en parlant d'éternité,
la seconde en affirmant qu'agiter ce problème est pathologique,
comme dirait Freud, et que c'est une bêtise. Je crois
l'inverse: nous avons intérêt à penser
à la mort tous les jours. Quand on regarde comment
on est fait - des petits morceaux de chair entourés
de peau rose ou brune - et qu'on voit qu'on peut à
la moindre coupure ou blessure souffrir ou mourir, je trouve
que l'angoisse n'est pas pathologique. C'est plutôt
un signe de lucidité, une injonction d'en faire quelque
chose.
Il faut apprendre à se résigner
à la condition humaine?
- Non, il ne faut pas se résigner. Nous ne sommes pas
faits pour cela. Epictète dit à son disciple:
«Quand tu embrasses ton fils ou ta fille, pense qu'il
peut mourir, il est comme la tasse en verre qui peut se casser.»
La question du deuil est fondamentale. Il y a la promesse
de la résurrection des corps, spécifique au
christianisme, et différente de la réincarnation,
qui, dans le bouddhisme, est une punition: on est réincarné
tant qu'on n'a pas atteint la sagesse. Le stoïcisme,
comme le bouddhisme, au fond, nous invite au non-attachement,
c'est-à-dire, finalement, à une forme de vie
monastique: on ne peut pas vraiment être «sage»
en famille, car on s'y attache forcément, à
ses proches. Or on ne peut mourir bien que si l'on détache
les adhérences: il faut voyager léger. Moi,
j'aurais envie de penser une troisième voie, une sagesse
de l'amour. Vivre avec des mortels nous l'impose. Par exemple,
se réconcilier avec les gens qu'on aime, en particulier
ses parents - avec lesquels on est forcément en conflit
- est un impératif de sagesse. Il ne s'agit pas en
l'occurrence d'une exigence morale. Il faut se réconcilier
parce qu'après ce sera trop tard. Autre exemple: avec
les gens qu'on aime, doit-on tirer les choses au clair en
cas de conflit, et jusqu'où? La somme de malentendus
qu'il y a dans une vie amoureuse ou amicale est quelque chose
de fascinant. Mais l'idéal de transparence n'est pas
le plus juste qui soit. On peut parfois communiquer beaucoup
mieux, de façon tout à fait authentique, par
des biais qui n'ont rien à voir avec la transparence
et la rationalité.
C'est ce que vous appelez la théorie du
«salut sans dieu»?
- La plupart des grandes théories philosophiques sont
des doctrines du salut sans dieu. Quelle est, par exemple,
la stratégie des stoïciens pour se sauver de cette
peur de la mort? Ils disent que la seule façon de s'en
débarrasser, c'est de comprendre par la theôria
que nous ne sommes qu'un fragment de l'ordre du monde, notre
«terrain de jeu», et de nous y ajuster - c'est
le but de la morale - pour y trouver notre place naturelle.
Il s'agit donc d'une réponse athée à
la peur de la mort, par la raison et par soi-même, et
non pas, comme dans les religions, par la foi et par Dieu.
Nietzsche parle de l'«amor fati» (amour de ce
qui est envoyé par le réel) et de l' «innocence
du devenir», ce moment où l'on accède
à la victoire contre les «passions tristes»
- culpabilité, regrets, nostalgie et espérance
- tous ces sentiments où se niche la peur. Même
dans la tradition matérialiste, on a donc affaire à
des doctrines du salut. Dans une autre tradition, lorsque
Kant se demande ce qu'il nous est permis d'espérer,
il pose aussi la question du salut.
Il s'agit, dites-vous, de construire une «vie
bonne» au sens philosophique du terme.
- C'est-à-dire une vie débarrassée du
caractère négatif des peurs, une vie qui accède
à la sagesse.
Est-ce que l'époque actuelle manque de
morale?
- Non, jamais nous n'avons vécu une époque aussi
bourrée de principes, d'éthique et de professions
de foi. La morale commune, en Occident, c'est celle des droits
de l'homme, qui est très belle et, quoi qu'on en dise,
largement pratiquée. C'est du kantisme appliqué.
Nous vivons dans une société pleine de morale,
mais vide de sens, de sagesse et de salut. On ne manque pas
d'éthique, mais de spiritualité.
Nous tournons à vide?
- Non. Mais la morale ne résout pas les problèmes
existentiels: à quoi sert de vieillir, comment éduquer
ses enfants, comment vivre le deuil de l'être aimé…
Vous protestez contre l'idée commune selon
laquelle la philo sert à poser des questions plutôt
qu'à offrir des réponses. Pourquoi?
- Cette illusion est liée au fait que lorsqu'on a institué
la classe de philosophie en 1906 en France, puis de par le
monde, on pensait que, pour exercer le droit de vote, moment
fort de la citoyenneté, il fallait être capable
de penser par soi-même, et donc de confronter les opinions
qui sont sur le marché. Voilà pourquoi on l'a
enseignée au seuil de la vie adulte. Je n'ai rien contre.
Mais ce qu'on enseigne - en gros, une réflexion sur
de grandes notions - relève plutôt à mes
yeux de l'instruction civique. Cela n'a rien à voir
avec la philosophie, qui tourne autour d'une problématique
en elle-même assez simple: comment parvenir à
une vie bonne? Ce sont les réponses, pas la question,
qui sont grandioses et très différentes aussi
les unes des autres.
La philo dès le collège, vous êtes
pour?
- Si l'on considère la philosophie comme un art du
débat ou de la réflexion critique sur les grandes
notions, pourquoi pas? Mais c'est de la «causette»,
comme on dit dans l'école de ma fille, de l'instruction
civique ou de la morale appliquée. Rien à voir
avec la philosophie.
Les cafés philo, c'est de la causette?
- Oui. Si on avait dit à Spinoza que la philosophie
consistait à débattre de la peine de mort et
à exprimer une pensée pour ou contre ceci ou
cela, il serait tombé de sa chaise. Cette conception
française de la philo est très liée à
l'héritage chrétien de la scolastique.
C'est-à-dire?
- Quand le christianisme l'a emporté, au IIe ou au
IIIe siècle, en Europe, sur la pensée antique,
les questions ultimes, de sens, de salut, de vie bonne, se
sont trouvées réglées par la religion.
Il ne restait plus à la philosophie qu'à clarifier
les concepts: c'est la scolastique. A quoi l'esprit républicain
a ajouté l'idéal du penser par soi-même,
donc de l'autonomie critique. Si la France est fille de l'Eglise
et mère de la République, le programme de philosophie
est doublement inscrit dans la tradition de ce pays.
C'est Nietzsche, dites-vous, qui va nous précipiter
dans la période présente.
- Il se prétend l'héritier des philosophes des
Lumières, mais il va les critiquer autant que les chrétiens
ou les Grecs. Il reprend d'ailleurs cet esprit critique des
Lumières - un acide que rien ne peut arrêter
- mais le pousse jusqu'au bout. Les démocrates républicains
des Lumières ont gardé à ses yeux quelque
chose de la religion, qui est l'idée d'idéal,
c'est-à-dire l'un des visages de l'opposition entre
l'ici-bas et l'au-delà. Or, selon Nietzsche, l'idéal
ne sert qu'à nier le réel. Nietzsche est à
la métaphysique ce que Schoenberg est à la musique
ou Picasso à la peinture. On ne peut plus revenir en
arrière. Mais je défends une philosophie reposant
sur une conception de la transcendance dans l'immanence à
soi qui échappe à mon sens à la déconstruction
nietzschéenne.
Pouvez-vous l'expliquer?
- Par exemple, quand on découvre une vérité,
si mince soit-elle - par exemple, 2 + 2 = 4 - c'est transcendant
par rapport à notre subjectivité particulière,
c'est une évidence, et pourtant c'est bien en soi qu'on
découvre cette vérité. Quand on tombe
amoureux, on aime quelqu'un qui est autre que soi, mais c'est
aussi en soi qu'on vit l'état amoureux: on a une transcendance
dans l'immanence, et ce n'est pas de l'ordre de l'idéal.
C'est sur elle qu'on peut construire un humanisme postnietzschéen
et postidéaliste. La problématique de la philosophie
contemporaine est là: quelle sagesse une telle transcendance
nous impose-t-elle?
Nous voici revenus à votre «sagesse
de l'amour» …
- Il y a dans l'amour de l'autre un appel à la transcendance
qui nous impose certaines exigences. C'est l'homme-dieu, l'homme
qui a en lui quelque chose qui nous appelle à la transcendance,
qui n'est pas un idéal, mais une réalité.
Pascal a écrit un texte sur l'amour que j'adore: est-ce
que je tombe amoureux parce qu'elle est comme ci ou comme
ça, qu'elle a telle ou telle qualité? Non. Ce
qu'on aime chez quelqu'un, ce ne sont ni ses qualités
objectives ni ses particularités locales, mais sa singularité.
Aimer quelqu'un, c'est pouvoir dire: «Ça, c'est
bien toi.» Savoir qu'il n'est pas remplaçable.
La sagesse consiste à apprendre à vivre avec
cette question: «Qu'est-ce que je fais de la singularité
que j'aime en l'autre, sachant qu'elle est atrocement fragile?»
Comment vaincre ma peur de le perdre? Ou plutôt, que
faire de cette peur? Voilà une vraie question philosophique.
Le succès actuel de la philosophie se
nourrit-il de l'échec de la pensée collective?
Chacun cherche pour soi, aujourd'hui.
- Depuis une quarantaine d'années, en Europe et en
France, le rapport entre l'individuel et le collectif, entre
la sphère privée et la sphère publique,
s'est inversé. En gros, on vivait dans une conception
du rôle de l'Etat qui était: lorsque l'intérêt
supérieur de la nation l'exige, la vie privée
doit se soumettre. Avec 68, le rapport s'est inversé.
L'Etat s'est très progressivement mis au service de
la réalisation des individus, et le sens de la vie
privée est devenu plus important que les intérêts
supérieurs de la nation. Un grand ministre, de nos
jours, n'est plus au service de la France, il est au service
des Français. Mais, au fond, nous avons tous les mêmes
préoccupations, soucis, conflits, peurs. A la vérité,
les problèmes individuels sont devenus les problèmes
collectifs d'aujourd'hui. La politique est devenue l'auxiliaire
de la vie privée. Mais servir les familles, c'est aussi
noble que servir la nation. L'individuel n'est pas à
opposer au collectif. Le collectif, c'est de l'individuel
répété. J'ai plutôt tendance à
penser que c'est un progrès. Donc, quand je parle philosophie
à ma fille, je m'adresse à tout le monde.
Propos recueillis par Jacqueline REMY
L’Express
du 12 octobre 2006
Droits réservés. |
|
|
|
|
|